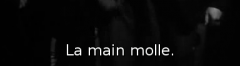jour vingt mille : lutte permanente :: et ce n’est que le début!
Ça vous rentre dans la peau. On n’en prend pas conscience tout de suite, seulement quand on regarde ce qu’on a toujours connu, ce qu’on laisse derrière soi, par les vitres de la voiture.
Ils longent les rues, les magasins, les coins de troittoir où ils se sont installés. Les fantômes du passé sont de sortie, le regard braqué sur eux. Peau douteuse, yeux renfoncés, sourires flippants.
Ils le sentent dans leurs os, même. Le pain, la picole, le béton. La beauté que ça renferme. Les souvenirs fragmentés qui les aveuglent. Prêcheurs, parents, ouvriers. Des idéalistes aux pupilles vides qui vont droit dans le mur. Les reverbères, les voitures, les cadavres à enterrer, les bébés à faire. Un boulot. Rien qu’un boulot.
Les gens se remettent à tuer au nom de leur dieu. L’argent nous anéantit. Leur solitude est si totale qu’elle sous-tend chaque amitié. Ils passent leurs journées le regards fixé sur des objets. Se fondent dans la masse, veulent suivre la foule. Leur credo, c’est la tendance. Leur horizon se limite aux soirées en boîte et à la défonce, les traits liquéfiés par l’alcool et la came, de la haine au fond des yeux le lendemain matin.
Écoute la ville tomber, Kate Tempest, Rivages poche, 2019